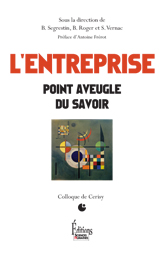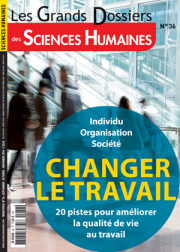Mais où donc la religion va-t-elle se nicher dans l’entreprise ? D’après l’étude de l’Observatoire du fait religieux en entreprise de l’IEP-Rennes (publiée en mai 2013), il n’y aurait que 6 % des situations touchant au fait religieux dans l’entreprise qui seraient conflictuelles et échapperaient au savoir-faire courant des managers. Cette étude montre aussi que seuls 2 % des managers, 12 % des cadres RH et 16 % des employés interrogés estiment qu’une loi serait « une solution à privilégier ». Ce constat rassurant est partagé, plus récemment, par le premier rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité, publié le 15 mai 2014.
La vraie dérive religieuse est ailleurs. Elle réside dans la généralisation parfois mal maîtrisée du management par les valeurs. Comme beaucoup de ses consœurs, cette approche managériale nous vient des États-Unis où se sont développés, à compter des années 1980, le « value based management » (VBM), aux origines très financières, et le « managing by values » (MBV), aux origines RH (cf. « Quelles valeurs pour l’entreprise », plus bas).
Cette approche n’est certainement pas à rejeter en bloc. Elle constitue une réponse pertinente à l’hypertrophie du prescrit, c’est-à-dire à l’omniprésence et à la précision des règles de comportements et des procédures héritées du taylorisme et du « business process engineering ». En cela, elle rend du pouvoir d’agir aux salariés, ce qui est positif. Il s’agit donc de préférer « l’entreprise gérée par ses vraies valeurs » plutôt que « l’entreprise gérée par ses mauvaises règles », comme le préconisait Jacques Horovitz (L’Entreprise humaniste, 2013). Le management par les valeurs prend acte du fait que dans une économie de la connaissance, très axée sur le service aux clients et caractérisée par l’évolution rapide des technologies et des produits, la versatilité de la demande et la multiplication des aléas, tout ne peut pas être prévu et codifié à l’avance : c’est la créativité, l’initiative et la capacité d’adaptation des salariés de terrain qui fait la différence. En cela, il constitue une quête éperdue pour réinstaurer de la stabilité, celle des valeurs, dans un monde en turbulences.
Mais comme beaucoup d’approches managériales venues d’autres contrées (qualité totale, lean management, etc.), l’importation s’accompagne souvent de perversion. Dans bon nombre d’entreprises, le management par les valeurs installe une nouvelle religion d’entreprise, avec ses textes sacrés (chartes), ses dogmes, son clergé, ses grands-messes (Xavier Baron, « Quand le management recourt à l’imaginaire religieux… »). Il tend à installer un langage préfabriqué, pire que la langue de bois et son politiquement correct : la langue de coton. La vacuité des incantations idéologiques est submergée par une novlangue des valeurs, une communication stéréotypée, parole abondante, mais qui n’imprime pas sur le corps social : haut débit mais peu de crédit.
L’un des signes les plus évidents de cette perversion est la dérive de l’évaluation professionnelle, qui s’est d’abord décentrée des résultats vers les comportements, puis vers le « respect des valeurs ». À tel point que dans bon nombre d’entreprises, l’adhésion aux valeurs finit par constituer l’un des critères, à parité avec la performance, pour déterminer les « talents » ou autres « hauts potentiels », à la faveur de conclaves qui ne brillent ni par leur ouverture ni par leur transparence.
En fonction de sa mise en œuvre, le management par les valeurs peut donc donner le meilleur ou le pire. Je propose ici quatre critères pour éviter qu’il ne se transforme en religion d’entreprise.
Se garder de l’irrationnel
Dans le numéro de la revue Futuribles consacré aux « Valeurs des Européens », (n° 395, juillet-aout 2013), Pierre Bréchon définit les valeurs comme « l’ensemble des orientations profondes d’un individu, ce qu’il croit, ce qui le motive, ce qui guide ses choix et son agir ». C’est donc une notion profondément personnelle. Il est plus difficile de les définir comme entité collective. C’est dans ce grand écart entre individuel et collectif que se glisse l’irrationnel, dont les excès en entreprise ont conduit deux professeurs de management de l’université de Standford, Jeffrey Pfeffer et Robert Sutton, à sonner l’alarme dans leur livre au titre explicite, Hard Facts, Dangerous Half-Truths and Total NonsenseJeffrey Pfeffer et Robert Sutton, Faits et foutaises dans le management, Vuibert, 2007.. Leur constat est simple : « Les décisions des entreprises reposent fréquemment sur l’espoir ou la peur, sur ce que les autres font, sur les idéologies chères aux dirigeants, sur ce qu’ils ont déjà fait ou sur ce qu’ils croient avoir été efficace dans le passé – bref, sur autre chose que des faits avérés. » Dans les entreprises dominées par l’affichage de valeurs et la perte de contact avec les faits, s’imposent progressivement les gourous, les derniers qui parlent, les adeptes des engouements passagers, les amateurs de storytelling et autres belles histoires… Les phénomènes de cour s’y développent, sous l’ombrelle des valeurs affichées par les dirigeants.
Mais « ceux qui vantent les mérites de l’individualisme forcené commettent une erreur de raisonnement. Ils oublient que l’expérience collective et les systèmes organisationnels influencent très fortement le comportement des individus et des organisations », rappellent les deux auteurs.
C’est donc le premier critère : manager par les valeurs doit s’accompagner d’un attachement au réel, aux faits. D’où l’approche proposée par les deux auteurs, sous le terme « evidence-based management », que l’on pourrait traduire par « management par les faits ».
Éviter les conflits éthiques
Les valeurs sont parmi nous… Elles existent, même si aucune démarche formalisée par le management n’a cherché à les déterminer ou à les communiquer. Une tâche essentielle consiste donc à les repérer et à identifier les situations de travail dans lesquelles elles posent éventuellement problème. Et l’on constate fréquemment que ces situations ne sont pas rares. Le Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail (RPS) a retenu de la littérature scientifique six axes pour qualifier les facteurs de RPS. Les conflits de valeurs constituent l’un de ces six axes : « La souffrance éthique, c’est-à-dire la souffrance ressentie par une personne à qui l’on demande d’agir en opposition avec ses valeurs professionnelles, sociales ou personnelles. La finalité du travail ou ses conditions d’exécution peuvent être à l’origine d’un conflit de valeurs » (rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail remis le 11 avril 2011 à Xavier Bertrand, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, par Jean-Philippe Cotis, directeur général de l’Insee).
L’enquête SIP (Santé et itinéraire professionnel) rendue publique en mars 2011 a montré que 6 % des actifs occupés estiment devoir « toujours » ou « souvent » faire dans leur travail « des choses qu’ils désapprouvent » (vente abusive, réalisation de licenciements…). Cette proportion s’élève à un tiers lorsqu’on y inclut les salariés déclarant avoir « parfois » de tels conflits éthiques.
Or, beaucoup d’entreprises en France préfèrent ignorer ces conflits de valeurs plutôt que de les affronter. En conséquence, la proportion des salariés dont le travail comporte des tâches en forte contradiction avec leurs valeurs personnelles est plus élevée en France (11 %) que pour la moyenne des 27 pays de l’UE (9 %) et en particulier l’Espagne (8 %), l’Allemagne (9 %), la Grande-Bretagne (10 %) et l’Italie (10 %), comme le montrent les résultats de l’enquête de la Fondation de Dublin (« Fifth working conditions survey - Overview report », Eurofound, avril 2012). Au-delà des conflits de valeur, des facteurs comme la honte ou l’impossibilité de faire du travail de qualité amènent les salariés à cacher fréquemment leurs émotions dans 36 % des cas en France, contre seulement 25 % pour la moyenne des 27 pays de l’UE et en particulier 19 % en Italie, 23 % en Espagne, 26 % en Allemagne et 30 % en Grande-Bretagne. Seules la Grèce, Chypre, la Lettonie et la Turquie présentent des taux plus élevés qu’en France.
Le management par les valeurs devrait commencer par affronter ces situations. Elles concernent d’ailleurs également ceux qui sont chargés de la gestion des ressources humaines et les dirigeants. Une étude de la Cegos publiée en juin 2012 nous apprenait que 37 % des DRH reconnaissent qu’il leur arrive d’agir contre leur éthique et leurs valeurs. Une autre étude du même organisme montrait que 44 % des cadres dirigeants déclarent avoir des difficultés à trouver une adéquation entre leurs valeurs personnelles et les obligations liées à leur rôle de patron (« Radioscopie CEGOS 2011 des cadres dirigeants en France », 19 octobre 2011, enquête sur 300 membres de comités de direction ou de Comex, menée en juin 2011).
Construire un terreau commun
Même mâtinées de culture d’entreprise, les valeurs sont d’abord une notion individuelle. Elles nous ramènent à nos croyances, à nos peurs et à nos espoirs, à nos convictions, à notre éthique personnelle. Si l’on veut transformer les valeurs en terreau commun, une simple communication ne suffit pas, même en rappelant que la communication est un processus qui fonctionne dans les deux sens, ce que la vaste majorité des directions de la communication persistent à oublier.
Il n’y a pas de valeur sans discussion, sans controverse sur les valeurs. C’est dans cette confrontation avec les collègues que les valeurs de chacun des salariés peuvent trouver un prolongement collectif. Au débouché de cette controverse, les salariés donnent du sens à leur travail en rapport avec la stratégie, l’organisation, les modes de régulation et le management. Les valeurs constituent le ciment de cette cohérence, qui dessine un projet dans lequel les collaborateurs peuvent se reconnaître et chercher à s’inscrire.
Au regard de chacune des valeurs promues dans l’entreprise, il faut travailler ensemble, dirigeants, management, représentants du personnel et salariés, pour déterminer comment elles s’inscrivent dans le quotidien des salariés : quels comportements sont attendus ou au contraire à proscrire ; comment diffuser et transmettre ces valeurs ; comment les rendre palpables par les clients ; comment arbitrer les inévitables conflits entre valeurs ? Ces échanges sont indispensables car ils permettent l’émergence du « nous » qui représente vraiment l’entreprise. Ils permettent aussi de débattre et partager ce qui apporte du bien-être, de la reconnaissance, mais aussi ce qui génère du mal-être, des dysfonctionnements, des insatisfactions…
Dans une approche de RSE (responsabilité sociale des entreprises), l’étape suivante consiste à élargir ces échanges auprès des parties prenantes internes à l’entreprise, puis à son écosystème (entreprise étendue : partenaires, clients, fournisseurs, etc.) et à ses territoires, afin de construire avec les parties prenantes.
Préférer l’incarnation à l’incantation
Les valeurs de « sens », comme le respect, la confiance, l’autonomie, l’utilité sociale, la reconnaissance et la qualité des relations, sont des facteurs essentiels du bien-être des salariés. La qualité de vie au travail résulte de la dialectique, plus ou moins harmonieuse, entre les valeurs affichées par l’entreprise et celles vécues par les salariés.
Mais les valeurs ne se « managent » pas, elles s’incarnent. Que penser de la multiplication des chartes des valeurs dans les entreprises ? Ce qu’en disait Yves Lichtenberger, professeur émérite à l’université Paris-Est-Marne-la-Vallée, vaut bien des discours : « Manager par les valeurs ? Les valeurs n’existent que par leur recréation constante, leur mise en pratique » (« Comment apprend-on à manager ? », colloque de l’Observatoire des cadres, 6 décembre 2013).
En effet, les valeurs doivent s’ancrer dans une réalité, dans le quotidien, le vécu et le ressenti des salariés. Elles sont l’âme du management, pas son outil. Elles doivent irriguer les pratiques de management. En particulier, il n’y a pas de management par les valeurs sans exemplarité du management.
Pour cela, la solution est de connecter les valeurs au travail. Il faut commencer par reconnaître la valeur du travail. Il faut ensuite inverser la démarche traditionnelle : plutôt que de pratiquer les flux poussés (projeter les valeurs ressenties par les dirigeants), il faut faire l’effort d’aller chercher et de questionner les valeurs mises en jeu dans les activités et les situations de travail. Comme le résumait le consultant Olivier Vassal, « ce qui importe et fonde la vraie identité d’une entreprise, ce sont les valeurs vécues plus que celles déclarées, les valeurs partagées davantage que celles promues » (Le Changement sans fin, 2008).
Si vous vous attachez à suivre ces quatre orientations, vous constaterez que manager par les valeurs, c’est recréer les conditions du « travailler ensemble », c’est-à-dire construire une intelligence partagée du travail.
Quelles valeurs pour l’entreprise ?
La valeur dans l’entreprise peut s’entendre de deux façons. La « création de valeur » ou la « valeur pour l’actionnaire » renvoie à la création de richesse, l’augmentation des bénéfices
ou du cours de l’action. Autres choses sont les valeurs éthique, d’égalité et de responsabilité sociales et environnementales.
- La « value based management » ou « gestion par la valeur » renvoie à la première signification. Ce mode de management a été promu à partir des années 1990 sous l’impulsion des actionnaires qui voulaient recentrer l’activité de l’entreprise autour de cet objectif central : la recherche du profit. Ce qui supposait de définir des critères de gestion spécifiques centrés sur la création de valeur, qui doit être l’unique « boussole » de la gestion. Mais cela entraîne aussi à repenser la contribution de l’homme (considéré comme un levier possible de la création de valeur).
- Le « managing by values » (manager par les valeurs) est une théorie du management tournée vers les « parties prenantes » (stakeholders) – salariés, managers, actionnaires, sous-traitants – qui prend en compte d’autres buts que la seule création de valeur financière : le social, l’environnement, l’éthique, l’égalité, etc. La RSE (responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise) s’inscrit dans cette optique.
Spécialiste de la conduite du changement concerté, de la santé au travail, de la maîtrise des fusions et des restructurations socialement responsables, Martin Richer aide les entreprises à définir et déployer leurs projets de transformation de façon durable, dans le respect de leurs parties prenantes. Il est aussi coordonnateur du pôle « Affaires sociales » de Terra Nova.