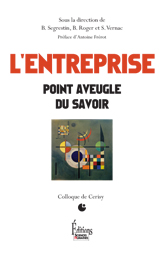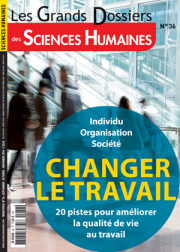Raconter le travail au quotidien pour mieux le comprendre, le transformer, l’organiser ou tout simplement pour le plaisir, tel est l’objet de nombreuses initiatives récentes. Les regards sont divers, les enjeux différents mais tous ont en commun de faire apparaître la partie immergée du continent « travail ».
« J’ai mis 15 ans à apprendre », « Le jeudi, je n’ai que deux heures de cours, pourtant j’en ressors toujours lessivée. » A priori, consacrer une heure de cours d’EPS à faire jouer au basket une classe de quatrième ne relève pas de l’exploit. Cela pourrait se décrire comme une « séquence » de cours simple : donner les consignes, constituer des équipes, faire jouer et noter. Pourtant Marie-Cécile craint le pire : le « chaos ». Chaque minute représente une épreuve. Il faut rassembler les enfants autour d’elle (alors que ça court déjà dans tous les sens), affronter le chahut (moqueries, éclats de rire, cris de scandale) quand elle annonce la constitution des équipes (qu’elle a mis un temps fou pour essayer d’équilibrer). Il y a ceux qui trépignent pour prendre les ballons, ceux qui discutent au lieu de s’échauffer… Ses collègues chevronnés lui avaient donné un conseil désarmant : « Pour le premier trimestre en sport co, surtout ne cherche pas à faire compliqué, tu débutes… Si après les vacances de la Toussaint tu réussis à constituer des équipes et à lancer des matchs, ce sera déjà un grand pas. »
Donner la parole aux invisibles
Déboussolée, Marie-Cécile a écrit son expérience sur Raconter le travail.fr, un site qui rassemble des récits d’enseignants et de personnels de l’éducation. à côté de celui de Marie-Cécile, on trouve le témoignage de Claire, CPE qui décrit ses démêlés avec les « élèves difficiles et parents déconnectés » ou le récit de Samir, infirmier en collège. Impulsé par un syndicat, le SGEN-CFDT, Raconter le travail s’inscrit dans le sillage du projet Raconter la vie impulsé par l’historien Pierre Rosanvallon
Derrière ces initiatives se profile un enjeu : celui du sens du travail. Pourquoi travaillons-nous ? En parler permet de mieux le saisir. Ségolène Journoux, chargée de mission à l’Anact (Agence nationale pour la qualité de vie au travail), rappelle que l’accord national interprofessionnel (Ani) sur la qualité de vie au travail, signé en juin 2013, a souligné que « la possibilité donnée aux salariés de s’exprimer sur leur travail, sur la qualité des biens et services qu’ils produisent, sur les conditions d’exercice du travail et sur l’efficacité du travail est l’un des éléments favorisant leur perception de la qualité de vie au travail et du sens donné au travail. » L’Anact consacrera d’ailleurs sa douzième semaine de qualité de vie au travail (du 15 au 19 juin) à ce thème : « Rendre le travail parlant »
Parmi les autres initiatives, un collectif, Dire le travail (direletravail.net), organise des ateliers d’écriture sur le travail. Les textes sont ensuite mis en ligne. Sur le site Changer le travail.fr, Sciences Humaines récolte des témoignages et propose des reportages sur les expériences professionnelles. Il existe aussi les initiatives spontanées de ces blogueurs – DRH, secrétaire médicale ou agent immobilier dépressif – qui décident de raconter les splendeurs et misères de leur journée de travail.
Décrire le travail : pourquoi faire ?
Il y a trois raisons principales de raconter le travail : comprendre, agir et se faire du bien.
La première raison, d’ordre scientifique, semble une évidence. Pour penser le travail, il faut d’abord le décrire. Et pourtant « les études d’ethnographe du travail » ne sont pas si nombreuses qu’on pourrait le penser, comme le notent les auteurs d’Observer le travail
Raconter le travail, c’est aussi une façon de le transformer. On peut envisager ces prises de parole dans une optique d’émancipation : parler est une première étape pour se libérer, révéler au grand jour les non-dits, faire reconnaître cette part invisible de l’activité qui n’entre pas dans les consignes : « On fait toujours plus et mieux que ce qu’on nous dit de faire. » C’est en ce sens que la coopérative Dire le travail se veut « engagée », avec la conviction que « dire le travail » contribue à « l’émancipation de ceux qui le font, voire le subissent ».
Certains syndicats, comme la CGT ou CFDT, soutiennent aussi cette nouvelle approche, après avoir pris conscience qu’ils avaient focalisé leur attention sur les conditions de travail, et non sur son contenu
Enfin, les managers et les décideurs ont eux aussi un intérêt à rendre le travail plus visible. Pierre-Yves Gomez, professeur à l’EM-Lyon, explique dans Le Travail invisible que la financiarisation de l’économie (qui découple la production de l’investissement), la mondialisation (qui éloigne les centres de production des centres de décision) et le management du travail (fondé sur une évaluation chiffrée) ont complètement coupé le manager de la connaissance du travail concret
Une fonction cathartique
Cette méconnaissance tient à une autre raison : l’autonomie des personnes, à la fois souhaitée par chacun et encouragée par les nouvelles méthodes managériales. Nombre de professionnels travaillent en gérant seuls leur agenda et leur façon de faire. La rançon de l’autonomie est que le travail n’est connu que de celui qui l’exécute, d’où le problème de la reconnaissance. Comment le travail pourrait être reconnu s’il n’est même pas connu ?
Enfin, raconter le travail revêt une fonction cathartique : cela permet de se défouler, de partager ses émotions avec une personne extérieure ou dans un journal personnel, mais aussi de prendre du recul et d’analyser ses propres pratiques. On se raconte aussi pour le plaisir de raconter et de parler. Beaucoup de gens adorent parler de leur travail quand on les interroge.
Comprendre, agir, témoigner, voilà trois bonnes raisons de raconter le travail. Reste à savoir comment.
Raconter le travail : a priori rien de plus simple. Il suffit d’avoir un stylo, un carnet de notes et un peu de temps. Mais tous les apprentis écrivains ou les chercheurs sont vite déroutés par l’ampleur et l’imprécision de la tâche : par quoi commencer ? Que dire ?
Tout dépend de l’œil de l’observateur. Comme pour un photographe, l’ethnographe ne peut saisir toute la réalité, mais seulement ce vers quoi il braque l’objectif. La réalité est complexe, protéiforme, il y a mille choses à voir, mille anecdotes à raconter… Une simple matinée de travail pourrait prendre des heures à être racontée par le menu. L’arrivée, le café, la réunion de service, les rencontres dans les couloirs, les courriels… Tout a-t-il du sens ?
Travail prescrit, travail réel
Qui dit travail invisible dit souvent « travail informel ». S’immerger dans le monde du travail, c’est se donner la possibilité de voir ce qui échappe habituellement au regard de la direction, aller au-delà du travail officiel tel qu’il est décrit par les organigrammes officiels. La distance entre le travail prescrit et le travail réel, le formel et l’informel, a d’ailleurs été l’un des thèmes favoris de la sociologie des organisations
Un autre thème privilégié d’observation porte sur les interactions entre personnels. Dans un lycée par exemple, l’enseignant, le directeur et le CPE participent chacun à la discipline scolaire, mais tous n’ont pas la même conception de l’ordre, de ce qui est acceptable ou non, des niveaux d’exigence. D’où des tensions et désaccords qui s’observent à des détails subtils : petites anicroches, remarques agacées, moues dubitatives ou franche prise de bec
Se faufiler à sa manière dans son poste
Raconter sur le travail, c’est mettre en lumière bien d’autres dimensions de l’activité professionnelle. Chaque personne s’approprie à sa façon un poste donné
Finalement, étudier le travail à la loupe, le raconter au quotidien, faire parler, écrire les professionnels révèlent mille enjeux implicites. Aucune grille de lecture ou démarche unique ne suffit pour l’englober. Au demeurant, l’ampleur du travail accompli est invisible pour celui même qui l’exécute.
Ainsi, Marie Cécile, notre professeure d’éducation physique se rappelle avoir très mal vécu la dernière séance de basket : « Un moment de chaos généralisé. » La séance suivante, son appréhension est à son comble quand elle affronte de nouveau la classe. Et à son grand étonnement, elle entend alors ses élèves lui demander : « Madame, on fait quoi aujourd’hui ? Comme la dernière fois ? C’était trop bien ! »
Profession : chauffeur-livreur
On souhaite tous que la supérette en bas de chez soi soit approvisionnée chaque jour en produits frais, que la pharmacie du coin ait les médicaments disponibles, que les journaux soient dans les kiosques et les colis urgents livrés à l’heure. Mais on voudrait se passer des camions qui livrent ses produits : ils encombrent et bloquent la circulation, ils polluent, ils font peur aux cyclistes. Les chauffeurs livreurs sont indispensables mais vivent dans un monde qui leur est hostile : les citadins ne les apprécient guère et leurs conditions de travail, soumises à des normes et à des rythmes de plus en plus exigeants, sont épuisantes.
Léon Kaba, une cinquantaine d’années, conduit un camion frigorifique et, tôt le matin, il vient livrer un supermarché en produits frais. Pour ne pas rompre la chaîne du froid, son moteur doit continuer à tourner, ce qui déplaît au voisinage. Il le sait mais ne peut faire autrement.
Le métier ne se résume pas à prendre le volant : il faut gérer un timing rigoureux, faire de la diplomatie avec des mécontents, garder son calme face aux vexations et aux agressions.
Fred Zeitoumi, lui, est patron d’une petite entreprise de messagerie qui sous-traite pour la grande distribution. Il tempête contre les charges sociales trop élevées mais met un point d’honneur à ne pas suivre le pas d’autres patrons qui ne déclarent leurs chauffeurs qu’à mi-temps, le reste du temps étant au noir…
Mohamed Zghonda, dit Momo, a conscience de faire partie de « privilégiés » : 1 800 euros par mois, un CDI dans une grande entreprise de messagerie, il est par ailleurs syndicaliste FO, et est donc un salarié « protégé ». Il tente de résister contre les conditions de plus en plus difficiles qui sont celles des myriades d’entreprises de transport.
Ève Charrin, journaliste, a accompagné ces chauffeurs dans leur tournée. Avec elle, on découvre les facettes d’un métier qui ne se résume par à la conduite sous stress mais qui a aussi ses charmes : la petite fierté de se sentir un père Noël qui vient remplir les rayons d’un magasin, livrer un colis tant attendu par un particulier, parfois une pochette de sang dans un hôpital. Un métier qui est fait aussi de poignées de main et de clins d’œil avec certains gardiens d’immeuble. Un métier où beaucoup continuent de se sentir libre dans leur camion, même si cette liberté est de plus en plus limitée. En fin de compte, ce que révèle l’enquête d’È. Charrin, c’est l’extraordinaire débrouillardise et maîtrise de soi dont font preuve ces travailleurs de l’ombre que sont les Sami, Mahomed ou Léon.
À LIRE Jean-François Dortier
|