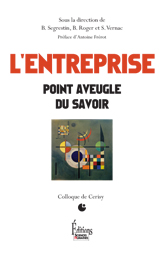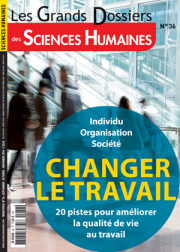Un exemple concret, expérimenté aux usines Renault, montre que la qualité du travail, dont la définition est loin d’être évidente, peut faire aussi l’objet de négociation dans le cadre du dialogue social.
N’y a-t-il pas un décalage entre le discours des salariés qui ont leur vision du travail et de ses exigences et celui des directions, tournées vers la mesure de la performance ?
Souvent les chercheurs pensent qu’une connaissance appuyée sur l’analyse du travail réel, visant à modifier les tâches et l’organisation du travail, mènera à une prise de conscience de la part de la direction. Or, un grand nombre d’entre elles, même lorsqu’elles trouvent ces recherches intéressantes, lancent des plans d’action qui n’aboutissent pas. Le problème n’est donc pas le manque de connaissances.
Comment êtes-vous intervenu chez Renault pour dépasser cette limite ?
Ne voulant pas jouer le rôle d’arbitre, nous nous sommes efforcés de prendre le problème autrement. Entre la CGT et la direction, il y avait conflit sur les critères définissant la qualité du travail. Tout est parti d’une recherche-action de la CGT dont le constat était que la qualité du travail n’était pas au rendez-vous et qu’il y avait gaspillage. La direction s’est alors tournée vers nous pour trancher cette question. Nous considérions qu’ils devaient en discuter. L’idée était de ne pas trancher au nom de l’expertise pour les sortir de ce conflit, mais d’enrichir le débat par nos observations et celles des opérateurs eux-mêmes. Plusieurs points de vue devaient être pris en compte, notre hypothèse étant que les indicateurs, des deux côtés, étaient sérieux. Nous avons donc travaillé avec tous les syndicats représentatifs (CFE-CGC, CFDT, CGT et FO). L’objectif était d’expérimenter un nouveau dialogue social, centré sur la qualité du travail, et non plus sur les salaires, la compétitivité ou l’emploi, même s’ils restent bien sûr des sujets importants. Il était notamment nécessaire de faire accepter aux uns et aux autres l’idée que les critères n’étaient pas homogènes, qu’il fallait donc trouver un nouveau compromis, les intervenants du Cnam faisant office de garants. Un dispositif tripartite a été mis en place, qui rassemblait les syndicats et la direction (opérationnelle, financière, etc.). Nous avons ensuite analysé le travail des opérateurs d’une chaîne de montage, en majorité des intérimaires, en recherchant les conflits de critères entre eux. Comme nous savions qu’ils avaient souvent trouvé d’eux-mêmes des modes opératoires plus efficaces, plus rapides, plus performants et meilleurs pour leur santé que ceux indiqués sur les fiches de poste, notre rôle « clinique » était de chercher les différences entre leurs manières de travailler et de les faire discuter sur ces points en les filmant. Ils en sont ainsi venus, après avoir eux-mêmes confronté leurs points de vue, à élaborer des diagnostics et à trouver des alternatives, bref, à mettre en œuvre leur créativité. Un montage de ces vidéos a ensuite été projeté devant la direction et les syndicats, leur donnant l’opportunité de discuter de ce travail directement et très concrètement. Il était important pour nous de montrer que les intérimaires se souciaient véritablement de leur travail. Ce cadre a permis de reprendre pied dans le travail réel. Pour cela, il était nécessaire que les opérateurs soient les sujets de l’analyse, qu’ils soient présents dans ces discussions, conflictuelles par nature.
Cela a-t-il suffi pour convaincre la direction de changements à apporter ?
Elle a d’abord été très impressionnée par l’intelligence des opérateurs, qui accomplissent bien au-delà des performances prescrites. Leur analyse a fini par peser dans le discours de la direction : mis devant l’approche très concrète et pragmatique des opérateurs, il lui était difficile d’échapper au réel, d’autant plus que les syndicats étaient également là pour exercer leurs responsabilités. Non seulement ils ont vu où se situait le problème, mais en plus ils ont dû s’engager dans le dialogue. Un échange sur le travail réel a donc bien eu lieu.
Comment faire pour pérenniser cette action au-delà de votre intervention ?
C’est en effet un vrai problème : que se passe-t-il une fois que nous avons le dos tourné ? La solution partielle que nous avons trouvée est que l’entreprise organise l’élection, par les opérateurs de deux des leurs qui seront référents par ligne. L’idée est de fabriquer une fonction, via un nouveau statut en cours d’élaboration, qui transforme l’organisation du travail.
Que pensez-vous des effets, en termes de participation des salariés à la définition du « bon travail », des réseaux sociaux d’entreprise ?
Je ne crois pas du tout que ces outils donnent accès au réel. Un dialogue un minimum institué me semble nécessaire, tout comme la création d’institutions alternatives, sollicitant d’autres interlocuteurs autour d’une « coopération conflictuelle ». Sans cela, les informations, virtuelles ou pas, risquent de se perdre. Un verrou institutionnel est indispensable pour le que le réel ne passe pas à la trappe.
La « boîte à idées » ne serait donc pas non plus, selon vous, une bonne solution ?
Même chose. Dans cette nouvelle institution, tout a été validé parce que ça a été discuté, et que l’on a participé à la décision d’application. À partir de là, on peut aller au-delà du poste et traiter de l’organisation du travail dans son ensemble : la ligne, le département, l’usine.
Quelle place pour les syndicats dans cette nouvelle forme de dialogue social ? Quid de leur capacité à canaliser l’expression des salariés ?
Il n’a en effet pas été facile pour eux, et pour la direction de Renault, de voir se déplacer le dialogue social et d’être confrontés à d’autres contraintes. Cela vient bousculer les lignes. D’autant plus qu’auparavant, l’opérateur senior était désigné par la direction. Désormais, les opérateurs référents seront élus par leurs collègues, et ce à tous les niveaux hiérarchiques. Par ailleurs, des discussions portent actuellement sur le statut de ce référent, pour savoir si un syndicaliste peut remplir ce rôle. Cela mènera peut-être à un renouveau du syndicalisme. Eux-mêmes affirment qu’ils ont besoin de retourner vers le travail réel. La coopération conflictuelle serait donc un instrument pour se rapprocher du réel. L’affrontement social ne disparaît pas pour autant, il en sort enrichi.
Vous insistez sur l’importance d’« en finir avec les risques psychosociaux »Yves Clot, Le Travail à cœur. Pour en finir avec les risques psychosociaux, La Découverte, 2010.. Pourquoi ?
Nous ne souhaitons simplement pas entrer dans ce sujet par les « risques », mais plutôt par les « ressources » du travail, en visant le développement de l’activité des salariés. Par RPS, j’entends plutôt « ressources psychologiques et sociales ». L’entrée par les ressources permet de développer un vrai engagement, le plaisir du travail bien fait. Il s’agit donc d’un autre moyen de promouvoir la santé, par un professionnalisme délibéré.
Yves Clot est titulaire de la chaire de psychologie du travail du Cnam. Il est notamment intervenu chez Renault. Il vient de publier, avec Michel Gollac, Le travail peut-il devenir supportable ? (Armand Colin, 2014).
A lire également : Qu’est-ce qu’un travail « bien fait » ?