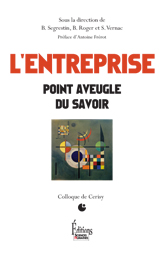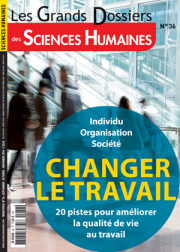Égalité, reconnaissance, autonomie : pour critiquer leurs conditions de travail, les Français invoquent des principes de justice très élaborés mais qui ne vont pas sans se contredire. D’où une ronde intarissable de critiques qui, loin d’aboutir à des mouvements solidaires, s’expriment surtout sur le mode individualiste.
Inégalités, exploitation, discrimination, racisme, sexisme, harcèlement, favoritisme, mépris, jalousie…, c’est un tableau extrêmement noir des représentations du travail que les Français, toutes catégories sociales confondues, livrent dans une récente enquêteCette recherche de l’université Bordeaux-II a été réalisée entre 2003 et 2005. Plus de 1 000 questionnaires ainsi que 300 entretiens individuels ont été passés. Des entretiens ont été menés dans différents univers de travail, ainsi que dans des collectifs professionnels. Cette enquête couvre un large panel de professions : agriculteurs, aides-soignantes, enseignants de tous niveaux, cadres, chauffeurs de taxi, chefs de rayon, ouvriers du bâtiment, hôtesses de caisse, etc. dirigée par le sociologue François DubetSociologue à l’université Bordeaux-II, directeur d’études à l’EHESS et membre du Cadis (Centre d’analyse et d’intervention sociologique), François Dubet est l’auteur de nombreux ouvrages sur les mouvements sociaux, les problèmes urbains, la marginalité juvénile, la délinquance, l’école, la socialisation, le travail et la théorie sociologique. Il a publié notamment Les Inégalités multipliées, L’Aube, 2001, Le Déclin de l’institution, Seuil, 2002, et L’École des chances. Qu’est-ce qu’une école juste ?, Seuil, 2004.. Et pourtant, tous et toutes attachent une grande importance au travail qui, dans cette enquête comme dans bien d’autres, vient en seconde position dans l’ordre des valeurs, juste après la famille..
Mais, paradoxalement, « alors que les statistiques montrent que, depuis trente ans, beaucoup d’inégalités se sont réduites, le sentiment d’injustice au travail n’a jamais été aussi fort », affirme F. Dubet…
Dans votre enquête, le discours critique sur les injustices au travail semble intarissable… Pouvez-vous en résumer la teneur ?
Lorsque l’on laisse parler les gens, on s’aperçoit qu’ils mobilisent des catégories philosophiques très élaborées pour étayer leurs propos, comme si tout le monde avait lu Aristote, Emmanuel Kant ou John Rawls… En fait, trois grands principes de justice sont évoqués lorsque l’on parle du travail : l’égalité, la reconnaissance du mérite et le respect de l’autonomie. Mais ces trois principes finissent par se contredire entre eux, et engendrent une ronde de critiques intarissable.
Au nom de l’égalité, on dénonce, entre autres, les difficultés que connaissent les immigrés, les femmes, les jeunes… Tout le monde sait que le travail est inégalitaire, mais tout le monde aussi veut des inégalités justes. C’est comme s’il y avait un seuil acceptable : par exemple, les enquêtés trouvent normal qu’un médecin gagne quatre fois plus qu’un employé, mais ils dénoncent aussi bien les salaires trop bas que ceux des patrons des grandes entreprises qui gagnent des millions d’euros par mois…
La reconnaissance du mérite, quant à elle, suppose que tout travail doit être rétribué à sa juste valeur. Au nom du mérite, les gens développent alors un discours anti-égalitaire : « Pourquoi, se révolte ce prof de lettres, alors que je fais dix-huit heures de cours et en ai autant de préparation et de correction, celui qui n’a que des préparations minimes et pas de correction touche le même salaire que moi ? »
D’un côté, on reconnaît le mérite dû au diplôme, de l’autre, on le conteste en mettant en avant l’investissement plus ou moins important de chacun : au nom d’un raisonnement utilitariste, on demande que les efforts soient reconnus et récompensés. Et l’on critique alors le piston, le copinage, les promotions canapés… qui viennent pervertir les épreuves.
Le troisième principe revendiqué est l’autonomie ; c’est elle qui doit garantir un espace de liberté et de créativité pour chacun. Sont alors dénoncées les situations qui produisent de l’aliénation : « Je suis correctement payé mais j’ai un travail qui est idiot », ou « qui m’humilie », ou « qui me stresse »… Là encore, les contradictions se font jour : « Je veux être reconnu comme l’égal des autres mais aussi comme individu singulier. »Au total, il se dégage de ces discours un sentiment d’injustice tel que le rapport au monde apparaît très noir…
Et pourtant, vos enquêtés finissent par avouer qu’ils aiment bien leur travail…
Il faut souligner que l’enquête révèle une satisfaction intrinsèque de travailler très forte : le fait d’avoir un travail garantit une capacité d’action. Mais plus les individus attendent du travail, plus la critique est forte…Au bout du compte cependant, après s’être livrés à cette critique généralisée, les gens finissent par dire : « Mais pour moi, ça va ! » 65 % des personnes interrogées sont dans ce cas.
Les sentiments d’injustice, très profondément individualisés, fondés sur des contextes de travail très précis, ne sont pas pour autant transformés en jugements sociaux. Comme c’était le cas par exemple lorsqu’il existait ce que l’on appelait la « conscience de classe »… On peut y voir une crise de la représentation qui fait que l’expérience personnelle n’est plus transformée en une interprétation organisée de la vie sociale. Cette interprétation ne se joue plus sur les luttes collectives dans le travail mais plutôt sur des thèmes évoquant l’existence menacée de la société : 85 % des personnes interrogées déclarent que la société va très mal et que certaines injustices – travail des enfants dans le monde, guerres, famines, le problème des SDF… – sont beaucoup plus graves, finalement, que celles qu’ils vivent.
Malgré tout, ces critiques virulentes sur le travail semblent aboutir à des réactions plus individualistes que solidaires…
D’abord, les plus exploités n’ont pas les ressources pour faire changer les choses. Ceux-là ont fortement intériorisé le fait que s’ils protestent trop, d’autres attendent pour prendre leur place… Il existe également une vive critique des syndicats qui sont plutôt vus comme des « machines à protéger les protégés ».
Mais ce qui nous a frappés dans cette recherche, c’est un discours récurrent qui consiste à considérer que ceux qui sont le plus victimes des injustices en sont responsables. Et plus on descend dans l’échelle sociale, moins la compassion est forte.
Par exemple, au nom de l’égalité, beaucoup trouvent scandaleux qu’il y ait des très pauvres, mais, au nom du mérite, ils trouvent tout aussi scandaleux que ces personnes s’enferment dans des systèmes d’assistance : on va alors blâmer la victime qui serait censée se prendre en charge. Et au nom de l’autonomie, on proteste alors contre l’abdication morale des individus.
Les principes de justice qui poussent à la révolte sont immédiatement contrecarrés par des principes moraux qui poussent à ne pas agir et à critiquer une certaine responsabilité des victimes dans leur condition… Et même les travailleurs qui subissent les humiliations les plus fortes refusent de se voir en victimes : « Si j’ai ce boulot de merde, c’est parce que je n’ai rien foutu à l’école ! » Tous revendiquent le principe d’autonomie selon lequel « je suis maître de ma vie », « c’est moi qui décide de mon sort ». Ce principe est si fortement intégré qu’il devient une formidable machine à culpabiliser. Il n’est pas tolérable de se percevoir en victime.
Comment alors les individus arrivent-ils à surmonter ces contradictions ?
Les personnes de l’enquête refusent les causes sociales au nom de principes individuels. La cause du malheur au travail est davantage vue par le prisme de la méchanceté des autres que par des dysfonctionnements du système : les gens qui vous insultent quand on tient un guichet, le petit chef persécuteur, le cadre harceleur… Il en ressort un affaiblissement évident des capacités d’action collective.
Max Weber avait bien évoqué cette « guerre des dieux » qui se jouait dans l’avènement des sociétés contemporaines : nous adorons des principes de justice tous aussi estimables, dont on ne veut sacrifier aucun, le grand problème étant qu’ils sont contradictoires entre eux et que, dans une certaine mesure, ils nous empêchent d’agir.
Je pense que nous n’avons pas quitté ce que M. Weber appelait le « pathos théologique de la modernité » : cette idée que le progrès, la nation, la raison, la liberté, l’individualisme… allaient pouvoir se réconcilier. Et les gens ne s’y trompent pas : tout le monde est conscient que l’on ne peut réconcilier ces principes de justice entre eux. Il est faux de penser que plus nous sommes libres plus nous sommes égaux ou plus nous sommes autonomes…
Ce qui est frappant aussi dans cette recherche, c’est l’extrême diversité du rapport que les individus entretiennent avec les injustices. Pour certains, elles sont dévastatrices : mon patron ne m’a pas dit bonjour… et le monde s’écroule !D’autres considèrent au contraire que les injustices les confrontent à des épreuves qui finalement les grandissent et leur permettent de devenir plus autonomes.
Avec le déclin des institutions, le monde construit de plus en plus d’épreuves subjectives pour les uns et les autres : alors se pose la question de savoir ce qu’est une société juste. Serait-ce une société qui permet à chacun d’avoir suffisamment d’esprit critique pour sortir grandi des épreuves auxquelles il se confronte ? Mais ceci suppose d’avoir suffisamment de ressources et de maîtrise de sa propre vie pour résister au monde tel qu’il est. Ceci devrait nous inviter à nous intéresser beaucoup plus aux problèmes du travail que nous le faisons : aujourd’hui les préoccupations liées à l’emploi finissent par nous faire oublier que le travail lui-même, l’autonomie qu’il confère sont une condition essentielle de la réalisation de soi et d’une société vivable.