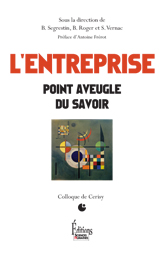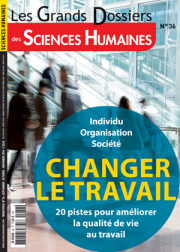En effet, dans la grande distribution, les consignes sont claires : les caissières sont les dernières personnes que le client rencontre et ce sont elles qui laissent la dernière image du magasin aux clients. « Face au client, un “bonjour”, un “s’il vous plaît”, un “au revoir, bonne journée” sont de rigueur ; et avec le sourire. »
Dans ce supermarché, les caisses sont filmées : une caméra de surveillance pour chacune d’entre elles, qui ne sert pas uniquement à repérer les vols mais aussi à contrôler le comportement de chaque caissière. Chaque caisse dispose également d’un téléphone directement relié à la caisse centrale ce qui permet d’avertir la caissière qu’elle doit modifier son comportement.
En fin de journée, la caissière envoie sa monnaie par aspiration dans la salle des comptes. Si une erreur se présente, même de vingt centimes, un mot est affiché avec le nom de la caissière à la vue de tout le personnel. Au bout de trois erreurs, la caissière reçoit un avertissement, au bout de trois avertissements, elle est licenciée… « Lorsque je faisais le compte de ma caisse en fin de journée, si je m’apercevais qu’il y avait une erreur, j’allais chercher l’argent qu’il manquait dans mon portefeuille afin de ne pas avoir d’avertissement, ce que font toutes les caissières. »
Par la signature de son contrat de travail, la caissière se trouve subordonnée aux normes de l’entreprise. Son poste suppose des manipulations de marchandises et d’argent. On constate la rigueur des normes : la caissière n’a pas droit à l’erreur. Remarques des clients (pas toujours aimables quand il manque une étiquette, quand l’attente est trop longue, etc.), contrôle de la direction, peur de l’erreur…, on comprend que le travail de la caissière soit fortement impacté par les relations émotionnelles. Il existe toujours un conflit latent entre ce que la caissière devrait faire pour maintenir son équilibre émotionnel personnel et ce qu’elle doit faire pour respecter les normes de l’entreprise. C’est le cas de la plupart des emplois.
Cet écart entre les attentes de l’individu au travail et les normes imposées par l’entreprise sont la source de multiples émotions : angoisse, frustration, peur, colère, parfois haine.
Les relations hiérarchiques se révèlent particulièrement propices à l’expression de ces émotions. Le style managérial influe beaucoup sur le type d’émotions sollicitées. À partir des témoignages de 404 salariés sur leurs supérieurs hiérarchiques, on peut dépeindre quatre catégories différentes de style hiérarchique : « chef », « patron », « supérieur hiérarchique » et « cadre n + 1 »C. Bourion, « Styles hiérarchiques et jeunes diplômés », Expansion Management Review, n° 118, septembre 2005.. Chacune est associée à un type d’émotion plus spécifique.
Sentiments du salarié et hiérarchie
• Le chef dirige principalement avec son « cerveau reptilien ». : un type de réaction assez archaïque s’appuyant sur la colère, la menace, l’intimidation. Ce style est utilisé dans 21 % des cas étudiés. 94 % des interventions du chef produisent des émotions aversives qui vont, d’une part, de la peur à la haine, d’autre part, du mécontentement au dégoût en passant par le mépris. Dans ce style, le rapport de force constitue la norme cardinale. Écoutons une jeune stagiaire qui travaille dans la restauration sous les ordres d’un « chef reptilien » : « Auparavant, je n’avais jamais eu envie de casser la figure de quelqu’un, mais ce soir-là je l’ai ressentie. Ce chef était insupportable, il était méchant, blessant et méprisant vis-à-vis de son personnel : combien de fois m’a-t-il dit que je ferais bien de perdre quelques kilos. Ses mains baladeuses, je ne les oublierai pas… C’était répugnant. Tout ce que j’ai appris durant cet été, ce fut comment garder mon calme, comment continuer à sourire et à être aimable lorsque je n’avais qu’une envie, celle de pleurer. »
• Le style « patron » est différent. Il utilise volontiers le paternalisme en distribuant compliments et reproches assortis parfois de « coups de gueule » ou à l’inverse de « primes motivantes ». Ce style est présent dans un tiers des cas étudiés. Dans 39 % de ses interventions, la posture du patron décrite bénéficie d’évaluations positives : reconnaissance, admiration, etc. Dans ce style, le respect constitue la norme cardinale. Écoutons ce cadre évoquer une altercation avec son patron. « J’étais énervé, je me suis levé et je me suis précipité à sa suite refermant la porte derrière moi. Je l’ai regardé et, calmement, je lui ai demandé s’il était normal qu’il se permette de me faire constamment des réflexions blessantes ? Il a réfléchi et il est resté pensif, je suis ressorti du bureau et il ne m’a jamais plus parlé d’une manière irrespectueuse. »
• Le supérieur hiérarchique ne se contente pas de prendre des décisions : remontrance ou récompense, il explique sa vision des choses, justifie ses choix. Ce style représente 37 % des cas. Il lui arrive aussi d’exprimer ses émotions quand les choses ne lui conviennent pas mais, au lieu de le faire explicitement, c’est sur un mode larvé. Il peut devenir distant et froid. Les salariés éprouvent tout de même du respect et de la légitimité pour 58 % d’entre eux à l’égard de ce type de direction. Ici, la relation est moins passionnelle, ce qui ne veut pas dire qu’il n’existe pas des émotions latentes de nature sociale – honte, fierté – où l’image de soi joue un rôle important.
• Enfin, le dirigeant « n + 1 » dirige en donnant systématiquement une justification à ses décisions. Dans 88 % des cas, les salariés éprouvent respect et légitimité, mais ce style ne représente que 9 % des cas analysés. Les émotions mobilisées relèvent de l’attachement et de la dépendance affective, avec leur cortège de petites frustrations et susceptibilités. Mais la relation hiérarchique établie laisse place à des dispositifs de régulation (écoute, échange, négociation…) qui permettent de tempérer rancœurs, colères et réactions brutales.
Aujourd’hui, un comportement professionnel ne doit plus être simplement performant, il doit aussi être légitime. Le respect d’autrui est devenu un critère essentiel de légitimité. Les attitudes menaçantes, la mauvaise humeur, les promesses non tenues, la tricherie, la violence verbale, les colères, les intimidations, les discriminations sont des pratiques prohibées et sanctionnées. Le harcèlement moral est identifié, dénoncé et reconnu depuis peu comme un délit. Il faut d’ailleurs signaler le revers de la médaille, la situation pouvant parfois s’inverser : provoquer un responsable pour le pousser à la faute peut se montrer très efficace dans la lutte contre l’autorité. En janvier 2008, un professeur en colère qui a donné une gifle suite à la provocation grossière d’un élève est interpellé à son domicile, interrogé, gardé à vue 23 heures avant de se voir inculpé de violence aggravée sur mineur.
Émotions négatives au travail
Ces nouvelles normes des relations au travail évitent, certes, les dérapages, mais réduisent aussi le droit à l’erreur et accroissent les tensions.
La peur, quant à elle, signale les situations professionnelles que l’on ne domine pas. Elle est très présente dans les entreprises, se manifestant dans de multiples situations : la peur d’affronter un collègue irascible, la peur du chef, mais aussi parfois la peur du subordonné (comme ce jeune professeur face à ses élèves) ; et aussi la peur lorsque les difficultés économiques entraînent l’angoisse du licenciement, jusqu’à la grande terreur du chômage, du déclassement.
La peur existe également lors de l’entrée en fonction dans un poste ou dans les situations que l’on ne domine pas. C’est la peur du novice. Dans son premier poste, face aux clients, aux fournisseurs ou à de nouveaux collègues, un salarié est confronté à des émotions fondamentales. Si face à une situation nouvelle et inconnue, le salarié réussit une tâche, il en éprouvera une joie légitime. Inversement, l’erreur occasionne déception, frustration, voire honte et culpabilité. Mais la peur peut aussi se révéler utile, comme dans le cas de l’échec assumé et transformé en expérience. Elle est alors une façon d’accéder à un savoir nouveau. Le salarié peut ainsi se sentir gratifié en accédant au « secret » qui permet de progresser. Il a appris ce qu’il ne faut pas faire et intégré un nouveau code de conduite qui relève des « ficelles du métier ».
D’où l’importance de considérer l’erreur non pas comme une faute mais comme une occasion d’apprendre. Cela passe notamment par une autoanalyse de ses échecs et une gestion de ses émotions. Apprendre de ses erreurs, c’est éviter les conduites régressives comme rejeter les responsabilités sur les autres ou se plaindre devant d’autres personnes. Pour un responsable qui doit recadrer un subordonné suite à un échec, cela suppose d’éviter de dénigrer la personne pour se focaliser sur la tâche et le problème à résoudre.
Pour cela, il est préférable d’éviter les conduites régressives telles que les jugements de valeur portés sur le personnel, le fait de se plaindre de ses employés devant d’autres personnes, à l’inverse de développer une fausse sympathie ou de jouer la séduction pour esquiver les problèmes.
Apprendre de ses émotions est fondamental pour s’améliorer. Mais cela ne préserve évidemment pas des échecs à répétition et des ruptures qui en découlentM. Maffesoli et C. Bourion (dir.), Ruptures et liens, Eska, 2007..
Les échecs à répétition peuvent constituer des signaux avertissant d’une rupture dommageable entre ce que l’on fait et ce qu’il faudrait faire. Il convient alors d’être aidé et soutenu au niveau relationnel, notamment dans le cadre familial. Mais il faut surtout renoncer à ses propres normes et en construire de nouvelles. On peut alors parler de « désapprentissage »Voir C. Bourion, Emotional Logic and Decision Making: The interface between professional upheaval and personnel evolution, Palgrave Macmillan, 2005, et La Logique émotionnelle, 2e éd., Eska, 2001.. Désapprendre, c’est se défaire de ses habitudes, de ses routines de travail, des cadres de pensée et d’action intériorisés et automatisés. Ce désapprentissage a un coût humain parfois élevé. Un échec produit d’abord du déni, de la colère, de la culpabilité, parfois de la dépression. La frustration générée peut donner envie de lâcher prise et de tout plaquer. Le désapprentissage est synonyme de souffrance. Et le changement de ses habitudes de travail est sans doute le type de changement le plus difficile.
La nécessaire souffrance de la remise en cause
Il faut de gros efforts pour transformer ses façons d’agir, trouver l’information utile qui permet d’apprendre et de désapprendreM. Thévenet et C. Bourion (dir.), Le Management de proximité, une question d’apprentissage émotionnel, Eska, 2007.. Cela suppose une reconstruction globale du sens que l’on donne à son travail. Reconstruire le sens, c’est supprimer des conduites stéréotypées pour en mettre en place de nouvelles, trouver d’autres sources de motivation et de plaisir, apprendre à dompter ses peurs et angoisses, établir de nouvelles relations avec ses collègues, reconfigurer sa place dans l’entreprise. C’est un véritable puzzle existentiel qu’il faut remonter où chaque pièce doit retrouver sa place.
Comme en témoigne ce salarié : « Chaque expérience bonne ou mauvaise nous enrichit. Il faut les analyser pour les comprendre afin de ne pas retomber dans les mêmes erreurs. » Avec ce sentiment que l’on peut toujours apprendre et progresser, mais qu’il n’est jamais de solution idéale et définitive car « la vie n’est pas linéaire, elle alterne les moments de joie avec les moments de tristesse ».
Christian Bourion
Professeur à l’ICN Business School de Nancy, il est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages sur le thème, notamment, avec Maurice Thévenet, du Management de proximité, une question d’apprentissage émotionnel, Eska, 2007.
Accéder au sommaire du dossier : Malaise au travail (Grands Dossiers N° 12 - automne 2008)