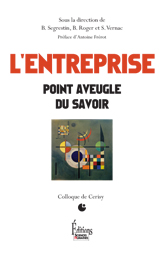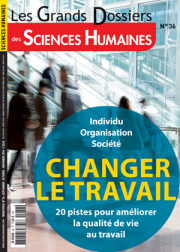Animer une équipe, monter un projet, lancer une campagne commerciale, diriger un bureau d’étude, etc., le travail des cadres n’est pas facile à décrire. Il est à la fois mal connu et souvent mal reconnu. Eparpillé, envahissant et insaisissable à la fois.
Le travail demeure un objet étrange, peu saisissable et pratiquement invisible. Curieusement, en effet, alors que le travail nous entoure, qu’il est au centre de nos conversations et demeure l’un des pivots de nos identités, il nous échappe. Nous savons bien des choses sur les conditions de travail, sur ses évolutions, sur le marché du travail, mais nous connaissons avec beaucoup moins de certitude ce dont il est fait, en quoi il consiste. Dans les conversations banales et quotidiennes que nous avons avec notre entourage, nous savons quels postes occupent nos proches, dans quelle entreprise ils évoluent, nous échangeons des anecdotes sur nos collègues, sur l’ambiance qui règne dans les bureaux ou les ateliers, nous déplorons la dégradation de nos conditions de travail, mais nous parlons très rarement, et parfois jamais, de ce que nous faisons. Finalement nous sommes souvent dans l’incapacité de dire ce que fait « vraiment » untel ou unetelle, de même que l’énoncé d’un titre ou d’une fonction n’évoque généralement pas grand-chose en dehors d’une position hiérarchique et d’un secteur d’activité.
Tenter d’en rendre compte, en se centrant explicitement sur ce que font les salariés, ne lève qu’en partie cette singularité du travail.
L’image du travail
L’observation des situations de travail révèle ainsi un aspect inattendu : au travail, on ne travaille pas nécessairement. Il suffit de jeter un coup d’œil derrière les fenêtres lorsque l’on déambule dans la rue et que l’on plonge dans les bureaux, de pénétrer dans un atelier, ou d’arpenter les couloirs des entreprises, pour s’étonner du spectacle qui est donné à voir. Que font, à première vue, les hommes et les femmes censés travailler ? Ils et elles discutent, se promènent, parfois avec un dossier sous le bras, parlent au téléphone, observent une machine, regardent un écran d’ordinateur, rient ou attendent on ne sait quoi. Ils s’activent, mais ne donnent que très rarement l’impression de travailler. Il est vrai aussi que parfois ils ne font rien, jouent sur leur ordinateur ou appellent leurs amis ou leurs enfants sur leur temps de travail. Dans bien des situations, lorsque les gens travaillent, ce qu’ils font ne correspond pas à l’image du travail. Car en dehors de situations très particulières, le travail demeure en grande partie invisible parce qu’il mobilise principalement des éléments cognitifs. Autant Charlie Chaplin dans Les Temps Modernes incarne une forme de travail repérable, le taylorisme, autant l’employé(e) de bureau, qui peut être cadre, les yeux rivés sur son ordinateur ou accroché(e) à son téléphone, n’évoque qu’un travail abstrait et insaisissable. Ce n’est probablement pas un hasard si le travail est si rarement représenté et incarné, s’il est si peu mis en scène à la télévision ou au cinéma par exemple. En dehors des policiers, des juges, des enseignants ou des médecins, les personnages travaillent peu : bien souvent, ils règlent plus des problèmes personnels et leurs peines de cœur qu’ils travaillent réellement.
Il demeure peu saisissable parce qu’il se déroule à l’abri du regard des autres. Entre eux, les salariés échangent beaucoup. Ils parlent de leur projet ou de leur dossier à leurs collègues, ils glanent auprès d’eux des informations, des tuyaux, ils leur soumettent leurs idées et parfois des bribes de leur travail. C’est pourquoi ils donnent d’abord l’impression de discuter, bien plus que de travailler, et cela d’autant plus que les échanges mélangent bien souvent différents registres : des éléments concernant le travail et des conversations relevant du café du commerce. En revanche, il est plus difficile d’observer les moments où ils s’y attellent, tout simplement parce qu’il n’y a pas nécessairement grand-chose à observer si ce n’est, dans la très grande majorité des cas, de constater qu’ils se déroulent devant un écran d’ordinateur. Concernant les ouvriers, en dehors des travaux de force, le constat est sensiblement le même. Dans les ateliers, ils regardent et surveillent les machines les yeux rivés sur des consoles. Les descriptions et les observations de la chaîne chez Citroën par Robert Linhart à la fin des années 1960 appartiennent au passéVoir Robert Linhart, L’Etabli, Seuil, 1978.. Le travail s’observe d’autant plus difficilement qu’il repose sur des éléments implicites et s’organise en amont avec la division du travail.
Le travail existe lorsqu’il devient public
Au quotidien, il n’est pas formellement distribué, parce qu’il va de soi que selon les tâches à accomplir il reviendra à untel ou unetelle dont les compétences et le poste occupé le ou la désignent automatiquement pour prendre en charge la question. Ainsi, dans bien des cas, le travail n’est rendu visible et perceptible qu’une fois accompli, quand il se matérialise sous forme d’objet ou de dossier, lorsqu’il devient public.
Pour en rendre compte, il est donc nécessaire de se tourner vers les salariés eux-mêmes et, tout en menant de front des observations de situation de travail, de décortiquer avec eux leur travail. Pour cela, une des manières de l’approcher n’est pas d’essayer de le décrire mais de tenter de le recomposer, c’est-à-dire de partir de l’objet réalisé pour remonter ensuite le fil jusqu’à ses origines et suivre ainsi toutes les étapes. Les quelques éléments qui suivent en livrent certains aspects, à partir d’une étude du travail des cadres dans une grande entreprise de la métallurgie. A travers quelques « manières de faire », la question de l’autonomie sera au centre du regard porté par les cadres sur leur travail.
Affronter le vide
Le management par les objectifs est une des caractéristiques des nouvelles formes d’organisation du travail. Il définit ce que l’entreprise attend des salariés et fixe ainsi les critères sur lesquels le travail sera évalué. Par ailleurs, dans l’accomplissement du travail, les règles et les normes de qualité délimitent de plus en plus précisément comment il faut s’y prendre et ce qu’il faut respecter. Le travail, à première vue, est donc encadré, faisant l’objet de procédures très précises et facilement repérables. Or, lorsque les cadres décrivent leur quotidien, c’est-à-dire les multiples tâches à accomplir, ils dressent un autre tableau. Loin d’être cohérente, l’entreprise apparaît au contraire pleine d’incohérences parce que les objectifs s’agencent difficilement les uns avec les autres ou parce que les procédures bloquent le travail. Pour réaliser leur travail, les cadres se heurtent à une machine qu’ils doivent tenter de surmonter et parfois contourner. L’un des premiers éléments du travail place ainsi les cadres face au vide. Pour faire ce qu’ils ont à faire, ils ne peuvent guère se fier aux règles et aux procédures, ni aux objectifs qui sont beaucoup trop vagues, ils doivent au contraire s’engager, imaginer, prendre des initiatives, proposer, bref affirmer leur autonomie et leur assurance. Or, la question à laquelle ils se confrontent est de savoir où se situe la frontière entre le possible et l’impossible. Tout semble possible a priori, et les entreprises ne cessent de relayer ce discours vantant la prise de risque mais, en même temps, personne ne sait vraiment si ça l’est. Ne pas s’engager les condamne et entrave toute possibilité d’action, mais s’engager n’offre aucune garantie. « Quand les choses se décident, raconte un cadre, le plus souvent ce n’est pas parce qu’elles ont été formellement acceptées, mais parce qu’il n’y a pas eu d’objection, la décision se prend par défaut : puisque personne n’y est opposé, alors tout le monde est d’accord, mais ce n’est jamais dit. La décision est prise parce qu’il n’y a pas eu de question. »
La situation place les cadres dans une position particulière où une grande part de leur travail consiste à traduire des demandes implicites. Ce travail de traduction s’opère à deux niveaux. D’une part, il s’agit d’essayer de donner corps à ce qui est en général énoncé au niveau d’une intention ou d’une orientation. Aux cadres et à leurs équipes de mettre en forme et de transcrire en action concrète ce qui relève d’une stratégie ou d’une politique. C’est lors de ce travail qu’ils se heurtent à l’incertitude de leur action ne sachant jamais s’ils seront entendus et cela d’autant plus que les stratégies et les politiques sont volatiles, qu’elles entrent parfois en concurrence les unes avec les autres, ou tout simplement qu’elles sont sujettes aux multiples changements internes et externes que connaissent les organisations. D’autre part, il s’agit pour les cadres d’être à l’affût, c’est-à-dire de capter, voire d’anticiper, des demandes ou des orientations qui ne sont pas toujours clairement formulées. Les cadres opèrent un travail de traduction dans le sens où ils doivent saisir des intentions, sentir en quelque sorte le vent du changement. Cette conduite les oblige à s’affirmer, à saisir des opportunités et à prendre la balle au bond. Il faut pour cela parfois réussir à tordre les intentions afin de placer un projet ou faire accepter une idée, ou même replacer un dossier antérieurement enterré. Les cadres doivent faire preuve de souplesse et de tact politique, parvenir à faire en sorte que leurs propositions s’imposent naturellement.
Faire face au vide place donc les cadres dans une situation singulière puisque l’autonomie dont ils disposent pour accomplir leur travail l’est par défaut. Ils sont sommés d’être autonomes, dans le sens où ils doivent s’engager, se jeter et s’engouffrer dans le flou. Ils doivent devenir les acteurs de leur propre travail, construire leur propre charge d’activité, tout en étant dans une très grande incertitude quant à la capacité de se faire entendre et de parvenir à le faire. Ils sont pris dans une injonction à être autonome, comme l’individu contemporain est sommé de se prendre en charge, de devenir acteur et responsable de sa destinée. L’autonomie existe donc par défaut, non pas parce que les cadres n’en bénéficieraient pas, mais parce qu’elle repose sur une obligation : ils n’ont guère le choix. C’est pourquoi, ils ont à son égard un regard ambivalent. L’autonomie est un des ressorts de l’action, ce qui leur permet de prendre des initiatives et finalement de faire ce qu’ils ont à faire, puisque c’est à partir de cette autonomie et cette capacité de traduction qu’ils réalisent leurs objectifs. Mais l’autonomie est aussi source d’incertitude et d’épuisement, puisqu’elle demeure fragile et incertaine, les cadres n’étant jamais sûrs de pouvoir faire ce qu’ils envisagent de faire.
Ruses et tricheries
Pour faire leur travail, les cadres sont aussi obligés d’innover. En effet, et comme les analyses du travail l’ont toujours pointé, en particulier l’ergonomie, entre le travail prescrit et le travail réel il existe des écarts notables et souvent se conformer aux consignes risque d’entraver le bon déroulement du travail. Les cadres, comme l’ensemble des salariés, doivent donc outrepasser les règles et les procédures, ne pas les suivre à la lettre et parfois même les transgresser pour arriver à faire leur travail. L’environnement de travail apparaît ainsi comme faisant obstacle au travail, il vient le perturber et le gêner, il empêche les acteurs de faire correctement ce qu’ils ont à faire. Pour y parvenir, il faut contourner les obstacles, ruser, trouver les ficelles, s’adapter et parfois tricher. Ici les cadres ont d’abord l’impression de se battre contre leur entreprise. De nouveau, ils se heurtent à son incohérence qui se traduit par des normes et des procédures inapplicables ou contradictoires, par des choix budgétaires et stratégiques vécus comme antinomiques avec ce qu’on leur demande de réaliser, ou encore par l’empilement des strates décisionnaires, ou des objectifs, qui ensemble ne s’accordent que trop rarement. Surmonter ces obstacles donne une teneur particulière au travail.
D’un côté, les cadres font preuve d’initiative et finalement éprouvent un sentiment de liberté en récupérant une part de leur travail. En effet, en contournant plus ou moins les règles ou en jonglant avec les contraintes, les cadres se réapproprient en partie leur travail. Il leur appartient dans la mesure où il est le résultat direct de leur engagement. Ce sentiment est d’autant plus fort, qu’ils ne peuvent guère revendiquer ce qu’ils ont mis en place, puisqu’ils ont par ailleurs violer certaines règles. D’un autre côté, ce sentiment de liberté laisse un goût amer, parce qu’ils ne peuvent guère le faire valoir. Toutes les ruses, les manières de faire mobilisées, voire les tricheries, restent des actes clandestins et participent en cela à l’invisibilité du travail. Si elle procure une part de fierté, les cadres savent aussi que cette part de leur travail restera souterraine et ne sera jamais prise en compte ni récompensée. A la non-reconnaissance de leur travail, s’ajoute l’ambivalence à l’égard de la transgression qui heurte bien souvent leur conscience professionnelle. Ne pas respecter les règles ou tricher, c’est aller contre les règles de l’art et parfois livrer un travail mal fait ou bâclé, c’est aussi prendre des risques et craindre de se faire prendre. Ainsi, alors même que le travail paraît a priori de plus en plus immatériel, lorsque les cadres évoquent cette nécessité de contourner les procédures, ils se réfèrent aussi à l’idée du beau travail, du travail bien fait. Ruser ou tricher se révèle être tout aussi existant qu’éprouvant et frustrant.
L’ambivalence du travail, entre satisfaction et pénibilité
Enfin, au quotidien, le travail est surtout fait d’une multiplicité d’activités sur lesquelles les cadres n’ont en réalité guère de maîtrise. Les journées sont pleines d’actes et de tâches qui viennent perturber le travail. C’est le téléphone qui ne cesse de sonner, les réunions qui s’enchaînent, le courrier électronique auquel il faut répondre et qui prend toujours beaucoup plus de temps que prévu, ou les collègues qui passent la tête dans le bureau et demandent des informations et embrayent sur un autre sujet mêlant travail et anecdotes. Tous ces instants, qui parfois occupent une grande part de la journée, ne sont jamais assimilés par les cadres au travail, ils viennent en plus et le parasite, alors même qu’ils en font intégralement partie. Mais, ils n’appartiennent pas au vrai travail, celui qui est consigné sur les fiches d’objectifs. « Dans l’entretien individuel, comme dans la définition de poste, explique un cadre, il n’y a pas marqué “mettre de l’huile dans les rouages, gérer les aléas”. Il n’y a pas marqué ça. Et c’est ça qui prend 80 % du temps. »
Ces quelques éléments du travail des cadres soulignent deux aspects indissociables donnant au travail sa singularité. Il est à la fois source de plaisir et de satisfaction, et une contrainte pesant sur les épaules des acteurs qui ne cessent de s’en plaindre. Source de plaisir, parce qu’il offre des marges d’action et de liberté et participe de la construction de soi. En effet, alors même que le travail et ses finalités échappent aux salariés et qu’ils ne sont bien souvent qu’un grain de sable dans la machine, le travail demeure un élément de construction de soi et ce qu’il y a à faire appartient à celles et ceux qui le réalisent. Par ailleurs, si toutes les activités et toutes les tâches ne sont pas intéressantes, elles ne sont pas non plus toutes dénuées de sens. En revanche, l’entreprise à travers ses modes d’organisation du travail et du management, à partir de ses choix stratégiques et politiques, est vécue comme un obstacle et une entrave au travail. Le propre du rapport au travail semble être pris dans ce va-et-vient incessant, entre satisfaction et pénibilité. Il n’y a pas d’un côté ceux qui s’affirment dans leur travail, jouissent d’une véritable autonomie et éprouvent du plaisir, et de l’autre ceux qui souffrent, qui voient leurs actions entravées par les contradictions de l’entreprise, et qui se sentent dépossédés de leur travail. Bien au contraire, les acteurs partagent tous ces expériences, sans pour autant les confondre ou n’en faire qu’une seule réalité. Ils soulignent la complexité et l’ambivalence des rapports au travail, mélange d’un profond attachement à ce qu’ils font et d’un désarroi, tout aussi grand, face aux multiples obstacles qu’ils doivent surmonter.
Olivier CousinProfesseur de sociologie à l’université Bordeaux‑II, chercheur associé au Centre d’analyse et d’intervention sociologiques (Cadis), il a publié Les Cadres à l’épreuve du travail, Presses universitaires de Rennes, 2008.
Accéder au sommaire du dossier : Le travail en quête de sens (Mensuel N° 210 - décembre 2009)