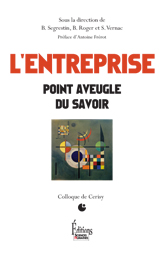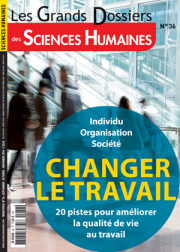Il n’y a pas deux façons identiques d’occuper une même poste. Au-delà des consignes prescrites, les individus et les groupes disposent de marges de manœuvre pour prendre en main leur travail à leur manière.
Quoi de plus ennuyeux, morne, impersonnel, sans attrait ni intérêt que le travail du planton, ce policier condamné à passer des heures dans une guérite à l’entrée du commissariat ?
Dans les années 1980, le sociologue Dominique Monjardet, l’un des pionniers de la sociologie de la police, eut l’idée d’aller observer ce que faisaient ces hommes qui n’avaient justement rien à faire d’autre que d’être là. Son idée était de montrer qu’un travail aussi pauvre et figé pouvait être investi de façon très différente selon la personne qui en a la charge.
Ainsi, le sociologue a pu observer que certains plantons entraient en contact avec des personnes hésitantes devant l’entrée, pour les renseigner et éventuellement nouer un dialogue, bref jouer l’agent d’accueil alors que ce n’était pas leur rôle. De même, quand il faisait froid ou quand il se passait quelque chose d’intéressant à l’intérieur du commissariat, il arrivait que le planton de service cherche à se rapprocher de l’entrée, à se glisser progressivement à l’intérieur pour rejoindre ses collègues. Et si le brigadier de service fermait les yeux, le planton abandonnait alors carrément son poste de faction. Ce jeu subtil montrait bien, aux yeux du sociologue, qu’il n’est aucun emploi aussi figé et rigide qui ne laisse des marges de manœuvre à celui qui l’occupe. Un même poste de travail : des façons particulières de s’en acquitter. Voilà ce que l’on peut appeler l’appropriation au travail.
Ce qui vaut pour le planton en faction devant son commissariat vaut a fortiori pour des métiers plus complexes : plombier, pâtissier, infirmier, avocat ou architecte. Un cours d’histoire n’est pas le même selon l’enseignant, sa personnalité, sa pédagogie, son engagement dans le métier et il n’est pas deux salles de rédaction d’un journal qui fonctionnent de la même façon.

Résistance, stratégie, identité et « pouvoir d’agir »
Philippe Bernoux vient de consacrer une étude à ce sujet : la manière dont chacun s’approprie son travail dans une organisation
Engagé pendant plusieurs mois dans les usines Berliet, il a constaté que les collectifs d’ouvriers géraient leur emploi du temps de façon très élastique, bien différente ce que supposait l’organisation officielle. Sur les ateliers de perçage et de soudage, les équipes avaient pris l’habitude de travailler de façon intensive (de « bourrer » comme on disait) pendant les premières heures de la journée pour ensuite relâcher complètement la pression (à une époque, désormais révolue, où l’on pouvait faire la journée de huit heures en trois ou quatre heures…). Cette façon collective de gérer le temps se fait par contrat tacite, avec l’accord implicite du chef d’équipe. P. Bernoux a consacré sa thèse à ce phénomène et en a tiré un livre, Un travail à soi (1981), qui a été précurseur dans l’étude d’un fait finalement banal dans de nombreux secteurs de travail. Même dans un secteur où le travail est apparemment très codifié, comme la programmation informatique, les professionnels disposent de marges de manœuvre. Ce qui ne fait pas l’affaire d’ailleurs de ceux qui souhaitent une normalisation des façons de coder un programme (encadré ci-dessous). De même, il existe presque autant de façons de faire du pain que de boulangers : chacun prétend avoir son mode de cuisson, son savoir-faire, son truc qui donne au pain une texture, un goût différents. Une séance chez le coiffeur ou au salon de beauté n’est pas la même selon la façon dont le coiffeur ou l’esthéticienne s’investit dans son travail ou dans sa relation humaine avec le client
L’appropriation de son travail est un phénomène universel : l’un des rares phénomènes que l’on peut qualifier d’« invariant du travail
• L’acte de résistance
La première forme d’appropriation observée par les sociologues du travail ouvrier est le « freinage ». On appelle ainsi une forme de tricherie conduisant à un ralentissement volontaire des cadences. Dans les usines taylorisées du début du 20e siècle, les ouvriers spécialisés étaient condamnés à des tâches infiniment répétitives (serrer toujours les mêmes boulons, souder toujours la même pièce, etc.). Le freinage avait déjà été observé par le sociologue américain Donald Roy, dans les usines américaines en 1944-1945
• L’action stratégique
Un autre cadre d’analyse relève de « l’analyse stratégique », inventée par Michel Crozier. Lors d’une célèbre enquête dans une manufacture de tabac, le père de la sociologie des organisations à la française avait révélé les petits jeux de stratégie et de pouvoir qui opposaient les ouvriers de production et les ouvriers d’entretien. Forts de leur compétence technique, les ouvriers d’entretien affirmaient leur pouvoir sur les autres. La maîtrise d’une « zone d’incertitude » (connaissance exclusive d’un savoir technique) leur donnait le pouvoir de faire arrêter la machine ou de décider seuls du temps qu’il faut pour la réparer, ce qui gênait souvent le travail des ouvriers de production. Dans ce jeu de positions, le savoir devenait un enjeu de pouvoir. Il permettait tout à la fois de défendre et étendre un territoire et de conquérir des avantages. S’approprier un travail, vu sous cet angle, est un moyen dont les acteurs font prévaloir leur loi au sein du système.
• L’identité au travail
Quand il a engagé ses propres enquêtes sur le travail ouvrier, P. Bernoux connaissait bien ces analyses précédentes : la résistance ouvrière vue dans le cadre marxiste de la lutte des classes, l’analyse stratégique de M. Crozier dans le cadre des jeux de pouvoir au sein d’une organisation. Lui-même a développé une autre approche : celle de l’identité au travail. Au sein d’une usine de construction de pièces automobiles, il a pu observer les comportements d’appropriation des ouvriers : les façons qu’avait chacun d’accommoder le travail à sa sauce, en rusant, en trichant sur le temps de travail (ralentissement), la tendance qu’avaient les anciens de s’approprier les meilleures machines et de laisser les machines « dégueulasses » (comme la taraudeuse) aux nouveaux. Ces stratégies étaient vues comme des façons « d’affirmer son identité », de « pouvoir exister ». Mais la notion d’« identité » peut se prêter elle-même à des interprétations très diverses. En cherchant à s’approprier leur travail, les ouvriers voulaient-ils améliorer leur propre confort, défendre leur conception du travail ou courir après une forme de reconnaissance, « être reconnus » ? Aujourd’hui, P. Bernoux penche vers cette dernière hypothèse en considérant qu’au fond, « l’appropriation est reliée à la reconnaissance ».
• Le pouvoir d’agir
P. Bernoux reconnaît avec beaucoup d’honnêteté intellectuelle, c’est assez rare pour être signalé, que son cadre d’analyse en termes d’identité au travail mérite d’être modifié en fonction d’une nouvelle grille d’analyse apparue depuis, à la confluence de la sociologie, de la psychologie et de l’ergonomie. Le travail est pensé en termes « d’activité » et les stratégies d’appropriation en termes de « pouvoir d’agir ». Le « pouvoir d’agir », notion développée par le psychologue Yves Clot
À la croisée de deux logiques
Le travail est à la rencontre de deux logiques : celle d’individus et de collectifs qui s’investissent dans une activité avec des projets, des buts qui leur sont propres, et celle des organisations qui imposent leurs contraintes, leurs règles et leurs cadences.
Il arrive parfois que les deux s’accordent et convergent. Mais le plus souvent, il existe un hiatus entre les deux. L’appropriation n’est autre que cet espace de liberté que les gens s’aménagent pour déployer leur propre espace, aspiration au sein d’un territoire contraint. Le travail ne se réduit à l’exécution servile de protocoles, consignes, cahier des charges. L’universalité de l’appropriation est la preuve qu’au travail comme ailleurs, la liberté et la créativité humaine sont incoercibles.
Informatique : les limites de l'appropriation
Amédée, 23 ans, est développeur informatique dans une société d’une quinzaine de salariés. La société, qui date des années 2000, crée des sites Internet. Elle a développé sa technologie « maison » à partir d’une solution libre.
Quand on l’interroge sur l’autonomie et les stratégies d’appropriation dans le travail d’informaticien, la réponse du jeune développeur ne fait aucun doute : l’appropriation existe, mais pas toujours pour le meilleur.
« Dans le travail tel qu’on le mène dans notre entreprise, il existe plusieurs niveaux de créativité. Le chef de projet conçoit d’abord le site – ergonomie, fonctionnalités, design – avec son équipe (et en lien avec les attentes du client), par exemple un site de vente de produits cosmétiques ou un site d’informations pour une collectivité. Il va ensuite devoir traduire les fonctionnalités du site en termes techniques. On appelle cela les “spécifications techniques”. »
Arrive alors le travail du développeur : il est l’« exécutant » qui va coder le programme. À ce stade, il existe des marges de manœuvres. En matière de « codage », il existe différentes écoles. On peut choisir le « langage objet » ou de « développement procédural » par exemple. « Dans ma société, nous sommes orientés vers un langage objet et avons choisi un logiciel libre que l’on adapte à différentes utilisations. » Mais il y a encore plusieurs manières d’utiliser le programme. On imagine souvent qu’un informaticien ne fait qu’aligner des lignes de code, sans y mettre sa patte. C’est une vision naïve. L’informatique est un langage qui a ses règles rigoureuses, comme le langage courant, mais il est possible de dire la même chose de dix manières différentes. Par exemple, on peut dire « bonjour » de plusieurs façons : « Bonjour, comment allez-vous ? », « Salut, ça va ? » ou encore « Hello, comment ça va ? » Trouver une bonne façon, élégante, de traduire une idée en langage informatique, c’est même l’un des intérêts du métier. La tendance aujourd’hui va vers une normalisation des codes, ne serait-ce que pour des questions de communication entre professionnels.
Vers un langage normalisé et commun
Si un client change de prestataire, le nouvel arrivé doit pouvoir comprendre ce qui a été fait pour prendre en main la suite. Or, si l’informaticien a développé ses propres raccourcis, son propre dialecte, il sera plus difficile de le décrypter. Si l’on veut transférer des fonctions, fusionner des sites ou des modules, il est impératif d’avoir un langage homogène. C’est pourquoi on voit se développer des programmes à partir de frameworks, sorte de patrons pour la conception de site, comme le framework Symfony, par exemple. Ces formules standardisées permettent de développer des modules adaptables : ils facilitent le développement et le transfert de modules d’un site à l’autre.
La mise en place d’un langage normalisé et unifié ne va pas sans résistances. Elle peut être ressentie comme contraignante et appauvrissante par les informaticiens. Mais en informatique, la logique de l’appropriation (personnelle ou par des communautés locales) conduirait à fabriquer des tours de Babel où chacun parle son langage. Cette logique est contradictoire avec le transfert de la communication et, finalement, la création collective. |